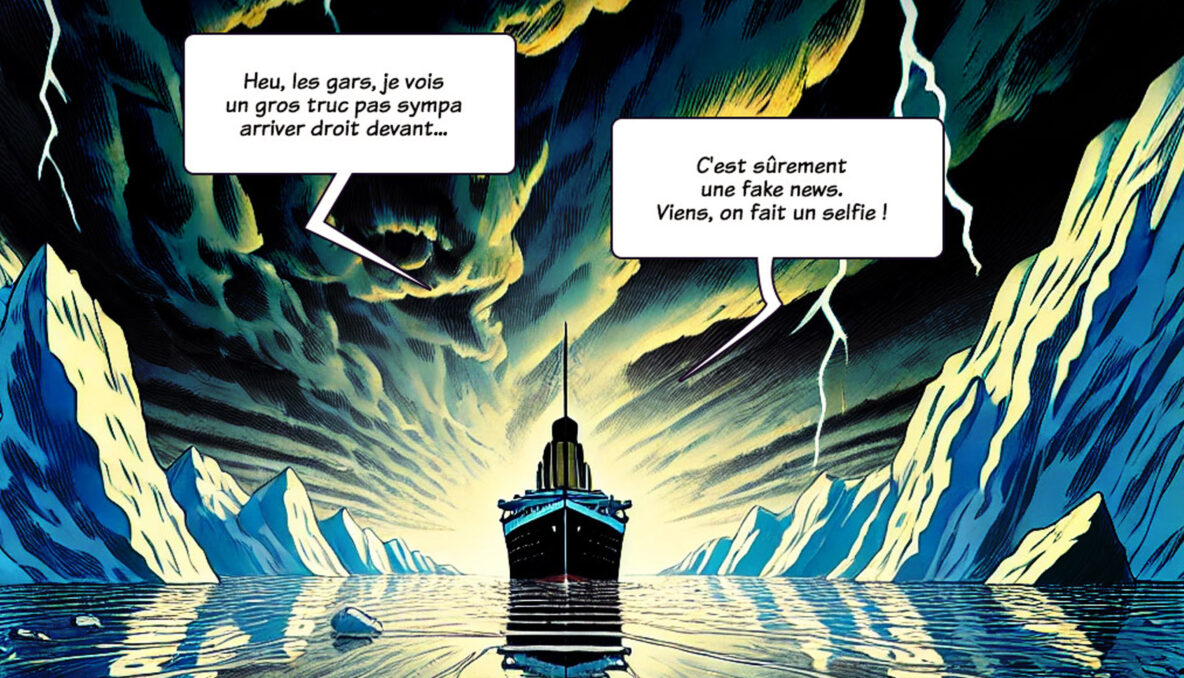L’intelligence de l’ombre
Saviez-vous que pendant que vous lisez ces lignes en sirotant votre café du matin, des milliers d’analystes dans les services de renseignement actualisent leurs scénarios de conflit mondial ? Que des généraux affinent leurs plans de mobilisation ? Que des responsables politiques préparent en secret des mesures d’exception ? Que des centres de recherche travaillent d’arrache-pied pour réaliser des percées qui pourraient éviter la catastrophe ?
Cette intelligence de l’ombre est aussi ancienne que le pouvoir lui-même. Déjà dans l’Égypte des pharaons, des réseaux d’informateurs scrutaient les crues du Nil et les déplacements de potentiels ennemis. Dans la Chine impériale, les services secrets des Tang rivalisaient de sophistication avec ceux des califes abbassides. À Rome, les frumentarii, ces espions déguisés en marchands de blé, tissaient leur toile à travers l’Empire.
Le Vatican a ensuite perfectionné cet héritage romain, développant au fil des siècles l’un des services de renseignement les plus sophistiqués de l’histoire : son réseau de prêtres, de missionnaires et de diplomates couvrait le monde entier, faisant remonter jusqu’au Saint-Siège des informations précieuses sur les cours royales, les mouvements populaires et les évolutions géopolitiques.
Au fil des siècles, cette intelligence s’est professionnalisée, structurée, industrialisée. Les guerres mondiales lui ont donné une dimension nouvelle, la guerre froide l’a transformée en une gigantesque machine bureaucratique, la révolution numérique en a fait un système nerveux planétaire capable d’intercepter le moindre signal d’alerte, allant jusqu’au mot-clé prononcé dans une phrase au téléphone. Rien qu’aux États-Unis, le rapport du directeur du renseignement national indique plus de 1 400 000 d’employés fédéraux et de contractuels détenant une habilitation « Top Secret » en 2010. C’est dire !
La tempête parfaite
Mais jamais, dans toute cette longue histoire, cette intelligence n’avait eu à faire face à des défis d’une telle ampleur et d’une telle complexité qu’aujourd’hui. Ce qui a changé ces dernières années, c’est à la fois la vitesse, l’intensité et la nature même des enjeux et des réponses à y apporter.
Depuis 2020, les signaux d’alerte se multiplient : la pandémie de COVID-19 expose la fragilité de nos systèmes, la guerre en Ukraine fracture définitivement l’ordre mondial post-guerre froide, tandis que les catastrophes climatiques et les tensions sino-occidentales atteignent des niveaux inédits.
Parallèlement, la nature des menaces évolue profondément. Celles-ci ne sont plus seulement militaires ou politiques : elles sont devenues systémiques, globales, existentielles. Il ne s’agit plus de scénarios isolés — une guerre ici, une catastrophe naturelle là — mais d’une convergence de crises qui s’alimentent mutuellement.
La prospective stratégique parle à ce propos de « tempête parfaite » : conflit mondial, effondrement climatique, migrations de masse, pandémies, tout cela pourrait survenir simultanément, créant un effet domino aux conséquences incalculables, potentiellement susceptibles d’éliminer l’espèce humaine toute entière.
Les signaux avant-coureurs
L’Histoire nous a appris que les plus grandes catastrophes arrivent rarement par surprise : elles s’annoncent à qui veut bien regarder. Et aujourd’hui, tous les voyants sont au rouge. En janvier 2024, un rapport de l’armée allemande à fuité dans la presse, indiquant un risque sérieux de troisième guerre mondiale dès l’été 2025. Il précisait que le risque serait accru si jamais Trump était élu car cela signifierait un abandon possible du bouclier américain sur l’Europe. En juillet 2024, le Monde parlait du moment que nous vivons comme la phase de « l’avant-guerre ».
Un autre sujet brûlant est celui des mouvements de population. Les projections à ce sujet sont encore très flottantes mais les derniers rapports citent entre 260 millions de réfugiés climatiques d’ici 2030 et jusqu’à 1,2 milliards d’ici 2050. Et il ne s’agit ici que des migrants climatiques, auquel il faut ajouter toutes les populations qui vont fuir les conflits, la tyrannie et la pauvreté.
L’effondrement de la biodiversité constitue une autre menace majeure. Les derniers rapports de l’IPBES indiquent que nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse, avec un taux d’extinction des espèces 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel. Or le seul effondrement des populations d’insectes pollinisateurs pourrait à lui seul provoquer une crise agricole mondiale sans précédent.
La déstabilisation du système financier mondial représente un autre facteur critique. L’accumulation de dettes souveraines colossales, la multiplication des bulles spéculatives et l’interconnexion croissante des marchés créent les conditions d’un possible effondrement systémique.
À cela s’ajoute la multiplication des pandémies. Les experts en santé publique alertent sur l’émergence accélérée de nouveaux pathogènes, favorisée par la déforestation, le réchauffement climatique et l’urbanisation intensive. Le COVID-19 n’était qu’un avant-goût : des virus bien plus létaux sont déjà identifiés comme menaces potentielles.
La fragilisation des infrastructures critiques constitue une autre vulnérabilité majeure. Qu’il s’agisse des réseaux électriques, des systèmes d’approvisionnement en eau, des chaînes logistiques ou des infrastructures numériques, nos sociétés reposent sur des systèmes complexes et interdépendants. Une défaillance en cascade pourrait paralyser des régions entières en quelques jours.
Schizo Land

Pourtant, dans nos vies quotidiennes, tout continue comme si de rien n’était. Nous débattons des élections à venir, des grandes rencontres sportives, du dernier film à la mode. Nous planifions nos vacances d’été, nous économisons pour le prochain Black Friday, nous nous inquiétons de la hausse des prix à la pompe, nous nous préoccupons du montant de nos retraites. Business as usual.
Cette dissonance cognitive, qui pourrait commencer à devenir comique si elle n’était pas aussi dramatique, n’a rien d’un accident. C’est un choix délibéré de nos dirigeants : face à l’ampleur monstrueuse des défis qui s’annoncent, ils ont opté pour une stratégie du silence.
Ce choix de maintenir les populations dans une relative ignorance peut sembler cynique, mais l’expérience du COVID a montré qu’une communication transparente sur des menaces existentielles pouvait provoquer des réactions contre-productives : déni, théories du complot, paralysie économique, fractures sociales profondes…
Ces réactions, en réalité, peuvent même très bien aller jusqu’à la guerre civile, qui est désormais un scénario anticipé dans beaucoup de pays. Dans cette optique, une stratégie graduelle d’adaptation des populations aux restrictions à venir paraît donc plus gérable qu’un choc brutal de vérité.
Un angle mort
Cependant, aussi compréhensible qu’il soit, ce calcul comporte un angle mort majeur : en privant les sociétés d’une compréhension claire des enjeux, on se prive aussi de leur formidable capacité d’adaptation et d’innovation. L’intelligence collective, cette faculté des communautés humaines à générer des solutions créatives face à l’adversité, reste notre meilleur atout face aux défis systémiques, car l’histoire nous montre que les sociétés peuvent faire preuve d’une résilience extraordinaire quand elles comprennent les enjeux et sont mobilisées vers un objectif commun.
Les exemples ne manquent pas : souvenez-vous du fameux : « je vous promets du sang et des larmes » de Churchill. Qu’il s’agisse de la mobilisation des peuples pendant la Seconde Guerre mondiale, de la reconstruction des pays en ruine ou de la réponse aux grandes catastrophes naturelles… À chaque fois, c’est la compréhension partagée du danger et la mobilisation collective qui ont permis de surmonter l’adversité.
En optant pour une stratégie du silence, nos dirigeants risquent donc de nous priver de notre ressource la plus précieuse : cette capacité collective à nous réinventer face à l’adversité. Car les solutions aux défis qui nous attendent ne viendront pas uniquement des cercles du pouvoir et des experts. Elles émergeront aussi des initiatives citoyennes, des innovations locales, des expérimentations sociales, de la créativité collective.
La puissance du réseau
D’autant plus que cette question de l’intelligence collective prend une dimension nouvelle à l’ère numérique. Les travaux fondateurs de Norbert Wiener sur la cybernétique, puis ceux de Claude Shannon sur la théorie de l’information, ont démontré que l’efficacité d’une organisation dépend largement du coût de circulation de l’information. Dans un contexte où l’information est rare et coûteuse à transmettre, les structures hiérarchiques pyramidales s’avèrent les plus efficientes : elles permettent de centraliser la prise de décision et d’optimiser la distribution des ressources informationnelles limitées.
Mais tout change quand le coût de l’information tend vers zéro. Les structures distribuées deviennent alors — massivement — plus performantes. Internet en est l’illustration parfaite : sa capacité à faire émerger des solutions innovantes, à s’auto-organiser et à s’adapter rapidement dépasse de loin celle de n’importe quelle organisation hiérarchique.
Car un réseau peut mobiliser simultanément des millions de nœuds interconnectés, chacun apportant sa perspective unique et sa capacité d’innovation. Cette « intelligence distribuée » s’est déjà illustrée dans d’innombrables domaines : les communautés open source, par exemple, sont une autre armée de l’ombre méconnue, mais qui sert le commun, c’est-à-dire de l’humanité entière, plutôt qu’une faction particulière.
L’intelligence du pouvoir et la sagesse de la multitude

Certains services de l’État ont d’ailleurs commencé à comprendre l’intérêt de cette approche distribuée. En France, la création de la Red Team Défense en 2019 en est un exemple emblématique. Cette équipe, qui réunit des auteurs de science-fiction, des futurologues, des scientifiques et des experts militaires, a pour mission d’imaginer les menaces futures et de mettre à l’épreuve les capacités de défense nationales. En mobilisant des imaginaires et des expertises diverses, elle permet d’explorer des scénarios que les approches traditionnelles n’auraient pas envisagés.
Aux États-Unis, la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) à crée le programme des « Grands Challenges », qui met en compétition des ingénieurs pour produire des technologies innovantes. En Grande-Bretagne, le Government Office for Science a mis en place des Futures Labs qui font appel à des réseaux d’experts citoyens pour explorer les enjeux émergents. Au Canada, le programme Policy Horizons mobilise systématiquement l’intelligence collective pour sa prospective stratégique.
Ces initiatives, bien que prometteuses, restent cependant marginales face à l’ampleur des défis. Elles démontrent pourtant qu’une autre voie est possible : celle d’une hybridation entre l’expertise des services spécialisés et l’intelligence collective citoyenne.
Un paradoxe fascinant
Ce qui mène droit à un paradoxe pour le moins fascinant. La séparation entre l’intelligence du pouvoir et la sagesse de la multitude remonte aux origines mêmes des premières civilisations. En Égypte ancienne, les prêtres et les pharaons monopolisaient les savoirs stratégiques pour asseoir leur domination. Cette compartimentation de l’information s’est ensuite sophistiquée au fil des millénaires, donnant naissance à ce que j’ai appelé ici l’intelligence de l’ombre.
Cette évolution était intimement liée à la compétition entre les empires, puis entre les États-nations : la maîtrise de l’information secrète constituait un avantage décisif dans la rivalité permanente entre les puissances. La guerre froide a porté cette logique à son paroxysme, avec la création d’immenses appareils de renseignement fonctionnant en vase clos.
Cette monopolisation progressive du savoir stratégique s’est accompagnée, en miroir, d’un processus délibéré d’infantilisation des masses. Des rituels somptuaires de l’Égypte ancienne aux fameux « pain et jeux » de Rome, du contrôle religieux médiéval à la société du divertissement contemporaine, les pouvoirs ont systématiquement œuvré à maintenir les populations dans un état d’infériorité intellectuelle.
L’essor des médias de masse n’a fait qu’amplifier ce phénomène, transformant les citoyens en consommateurs passifs d’une information calibrée pour ne pas troubler l’ordre établi. Et tout le savoir stratégique dont la multitude a été privée a fini par se transformer dans le complotisme, le conspirationnisme, etc., qui sont autant de réactions psychiques de compensation à une connaissance présente, mais rendue inaccessible au plus grand nombre.
Le Titanic mondial
Mais aujourd’hui, un renversement historique se produit : les menaces auxquelles nous faisons face sont par nature globales et transcendent les frontières nationales, si bien que — et c’est une véritable première dans notre histoire — la survie collective prime sur la compétition entre États.
On pourrait comparer l’humanité actuelle à un paquebot géant qui vient de voir qu’elle se dirige vers un immense iceberg. Sur le pont supérieur, dans les cabines de luxe, les élites continuent leur bal mondain. Dans les salles des machines, les classes laborieuses maintiennent le navire en marche. Et sur la passerelle de commandement, nos dirigeants se disputent le contrôle de la barre.
Certains veulent accélérer, persuadés que la vitesse nous sauvera. D’autres préconisent un virage serré à tribord ou à bâbord, selon leurs convictions idéologiques. D’autres encore nient simplement l’existence de l’iceberg, malgré les alertes répétées des vigies. Pendant ce temps, dans les compartiments étanches, les services de sécurité et les centres de recherche accumulent des données sur la menace chacun dans leur coin mais hésitent à les partager, de peur de créer une panique ou de perdre un avantage concurrentiel.
L’ultime retournement
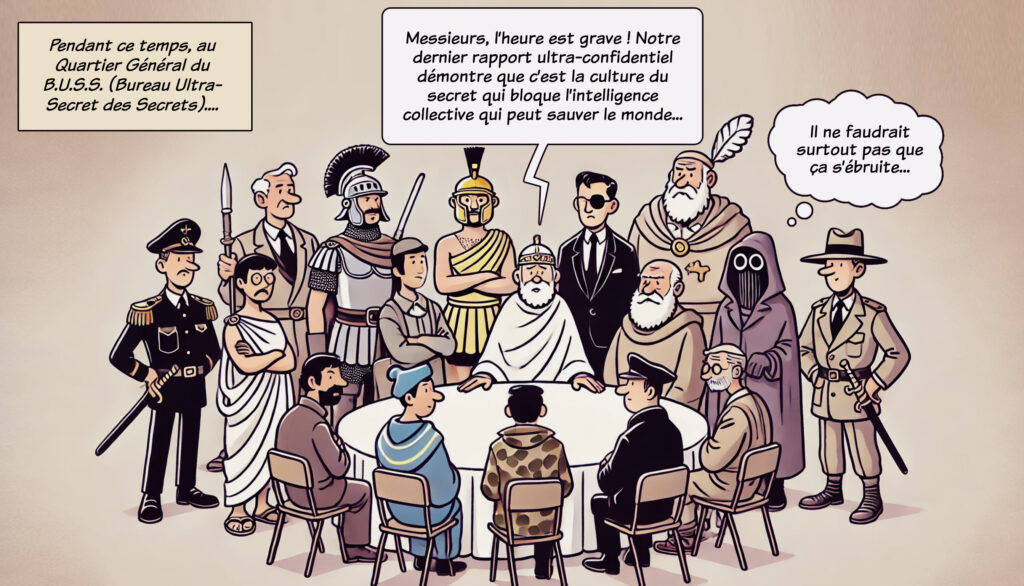
Quand on regarde cette situation à l’échelle d’histoire de l’espèce humaine depuis son apparition, elle ne manque pas d’ironie poétique. Pour l’instant, le niveau de menace pousse les Etats à instrumentaliser l’intelligence collective dans une logique compétitive : chaque puissance cherche à mobiliser « son » réseau d’innovation, « sa » communauté scientifique, « ses » capacités d’adaptation collective.
Mais il y a quelque chose de profondément absurde dans cette tentative d’instrumentaliser une intelligence collective qui, par nature, transcende les intérêts particuliers. Car pourquoi s’obstiner à détourner une force qui œuvre naturellement pour le bien commun ? Pourquoi ne pas plutôt s’aligner avec elle ?
Evidemment, la réponse est que les élites développent une telle dépendance au pouvoir qu’elles vont tout faire pour le garder. L’un des principaux facteurs d’effondrement civilisationnel dans le passé a d’ailleurs précisément consisté dans cette surconcentration de richesses et de pouvoir combiné à une sentiment d’impunité totale chez des élites devenues aussi vaines qu’idiotes, à entendre ici au sens étymologiques du mot, qui veut dire « isolé », « coupé du réel ».
Cependant, si les menaces atteignent un niveau véritablement existentiel — et tout indique que c’est le cas — nous pourrions assister à un retournement spectaculaire : le retour à une configuration qui prévalait il y a des millions d’années, celle de l’espèce humaine entière qui s’unit face à des menaces communes.
La mémoire atavique
Cette dynamique est profondément ancrée dans notre histoire évolutive. Pendant 99% de son existence, l’humanité a survécu parce qu’elle vivait en harmonie avec le vivant et qu’elle collaborait spontanément face aux dangers. Ces schémas collaboratifs sont inscrits dans notre mémoire commune, dans nos structures neurologiques, dans nos comportements sociaux les plus fondamentaux.
Les anthropologues ont documenté la façon dont ces mécanismes de survie collective se réactivent spontanément face aux menaces d’extinction : effacement temporaire des hiérarchies, mise en commun des ressources, partage accéléré des informations vitales, mobilisation des savoirs ancestraux.
Cette couche profonde de notre logiciel psychique collectif a été mise en sommeil par les millénaires de compétition acharnée qui ont accompagné l’émergence des civilisations, mais elle est bien présente, et les méga-crises qui s’annoncent pourraient nous ramener à ces fondamentaux évolutifs.
Accélérer le réveil collectif
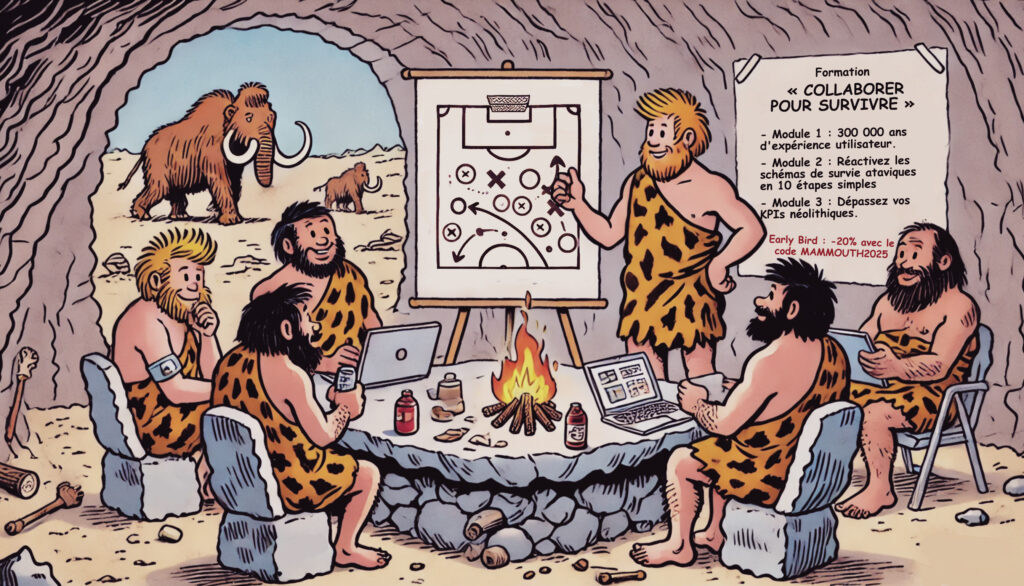
J’utilise ici le conditionnel car il faut malgré tout comprendre que même si elle est récente envisagée à l’échelle de l’espèce, la strate psychique basée sur la peur, la compétition, la possessivité et l’égoïsme est l’équivalent d’une couche de béton qui interdit pour l’instant l’accès à notre potentiel créatif et collaboratif véritable.
Cet article ouvre donc une série qui va explorer la possibilité de créer une série de « hacks » de notre logiciel psychique collectif pour libérer cette énergie. Mon ambition n’est pas ici de proposer un nouveau grand récit qui viendrait remplacer les mythes défaillants de la modernité. L’effondrement des paradigmes dominants va naturellement susciter l’émergence d’une multitude de récits alternatifs et de communautés expérimentales dans les années à venir, qui font faire émerger de nouveaux modes d’organisation collective adaptés aux défis qui nous attendent.
L’objectif de ces articles est plus pragmatique : fournir une série d’outils conceptuels et pratiques pour accompagner cette émergence. Car si les initiatives ne manqueront pas, leur capacité à mobiliser effectivement notre intelligence collective profonde et à ne pas finir instrumentalisées par le système qu’elles veulent dépasser dépendra largement des grilles de lecture et des méthodes qu’elles utiliseront.
Ces hacks psychosociaux passent par répondre aux questions suivantes : comment réactiver nos capacités collaboratives ancestrales tout en les adaptant aux réalités contemporaines ? Comment contourner les verrous mentaux hérités de millénaires de compétition ? Comment catalyser l’émergence de nouvelles formes d’intelligence collective qui combinent la puissance des réseaux numériques et la sagesse de notre mémoire évolutive ?
Le grand saut de conscience
Il s’agit, en quelque sorte, de constituer une boîte à outils pour les bâtisseurs du monde d’après. Non pas pour leur dire quelle forme ce monde devrait prendre, mais pour les aider à libérer le potentiel créatif et collaboratif dont nous aurons cruellement besoin pour traverser les turbulences qui s’annoncent et faire ce que je nomme « le grand saut de conscience planétaire ».
Car la plupart des réponses actuelles que nous apportons aux défis qui nous attendent ressemblent à des pansements sur une jambe de bois. Les formations à l’IA, les politiques RSE, les chartes éthiques sont certes nécessaires, mais ils restent dramatiquement insuffisants s’ils ne s’accompagnent pas d’un choc de conscience. C’est un peu comme si, sur notre Titanic métaphorique, nous nous contentions de repeindre la coque et de réorganiser le service en salle pendant que l’iceberg se rapproche.
Le véritable enjeu se situe à un niveau bien plus profond : il s’agit de sortir de l’histoire essentiellement subie et compétitive que nous avons connue jusqu’ici pour entrer dans une nouvelle phase de l’aventure humaine. Cette transition ne peut se faire par de simples ajustements organisationnels ou technologiques — elle exige une véritable mutation de notre pensée collective.
La limites des outils actuels
Pour donner un exemple concret, j’ai pendant des années pratiqué les « processus vision » pour accompagner les organisations. Ceux-ci reposent sur l’idée que lorsqu’une entreprise définit sa raison d’être, ses missions et ses valeurs, ses collaborateurs deviennent d’une part autonomes car ils comprennent par eux-mêmes ce qu’ils ont besoin de faire, et d’autre part engagés car leur raison d’être s’harmonise avec celle de l’entreprise.
Mais le problème est que ces exercices se déroulent toujours à l’intérieur d’un cadre de référence hérité, qui est celui de la civilisation moderne, qui repose sur un système de croyances qui est en train de s’effondrer à grande vitesse. Face aux défis existentiels qui nous attendent, de nombreuses organisations tentent de se transformer à travers des démarches fragmentées. Bien qu’utiles, ces approches restent insuffisantes car elles ne questionnent pas les impensés systémiques profonds qui conditionnent notre façon même de voir le monde.
La question fondamentale n’est plus « comment exister dans le monde actuel ? » mais « dans quel monde voulons-nous exister ? » Il ne s’agit plus simplement de choisir la bonne route, mais de se demander où cette route nous conduit.
Cette réinvention implique de créer ce qu’on pourrait appeler un méta-référentiel : un cadre de pensée qui nous permette d’examiner et de transformer nos cadres de pensée habituels. C’est un exercice vertigineux, car il nous demande de questionner les fondements mêmes de notre façon de concevoir la civilisation et de réfléchir à ce qu’elle peut devenir à présent.
L’horizon temporel comme clé de lecture
Ce qui me frappe dans ce panorama des menaces actuelles, c’est le contraste saisissant entre l’ampleur des défis et le rétrécissement de notre horizon temporel collectif. Il y a quelques décennies à peine, la pensée stratégique des organisations se projetait naturellement sur 30 à 50 ans. Les grands groupes industriels, les États, les institutions internationales élaboraient des plans à très long terme qui structuraient leur action présente.
Aujourd’hui, face à un monde devenu BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible), la plupart des leaders se contentent de gérer l’immédiat. L’horizon temporel s’est dramatiquement rétréci : même les plus grandes organisations peinent à se projeter au-delà de 2-3 ans.
Cette myopie stratégique est particulièrement dangereuse car elle nous prive des outils conceptuels nécessaires pour appréhender les méga-crises qui s’annoncent. C’est lorsque la visibilité est minimale que la vision doit être maximale. Les vrais leaders de 2030 se construisent aujourd’hui sur leur compréhension de 2050 : ils s’appuient sur l’analyse des cycles historiques longs pour identifier les tendances de fond qui façonneront l’avenir.
La métastratégie comme différenciant
Cette capacité à penser au-delà des horizons conventionnels définit ce que j’appelle la métastratégie : l’art de repenser les règles du jeu plutôt que de simplement jouer le jeu existant. Elle implique de sortir des cadres habituels pour imaginer de nouveaux paradigmes civilisationnels vers lesquels nous pouvons évoluer.
Dans un monde BANI (Brittle, Anxious, Non-linear, Incomprehensible, qui traduit littéralement Fragile, Anxieux, Non-linéaire et Incompréhensible), la métastratégie devient le principal différenciant entre les organisations qui survivront et celles qui disparaîtront. Car les solutions aux défis systémiques ne viendront pas d’une simple optimisation des modèles existants, mais d’une réinvention profonde de nos modes d’organisation et de pensée.
Cette approche métastratégique s’appuie sur trois piliers fondamentaux :
- La compréhension des cycles historiques longs
- La capacité à identifier les signaux faibles annonciateurs de ruptures
- L’aptitude à concevoir des futurs radicalement différents
La ligne magique : entre métastratégie et résilience tactique
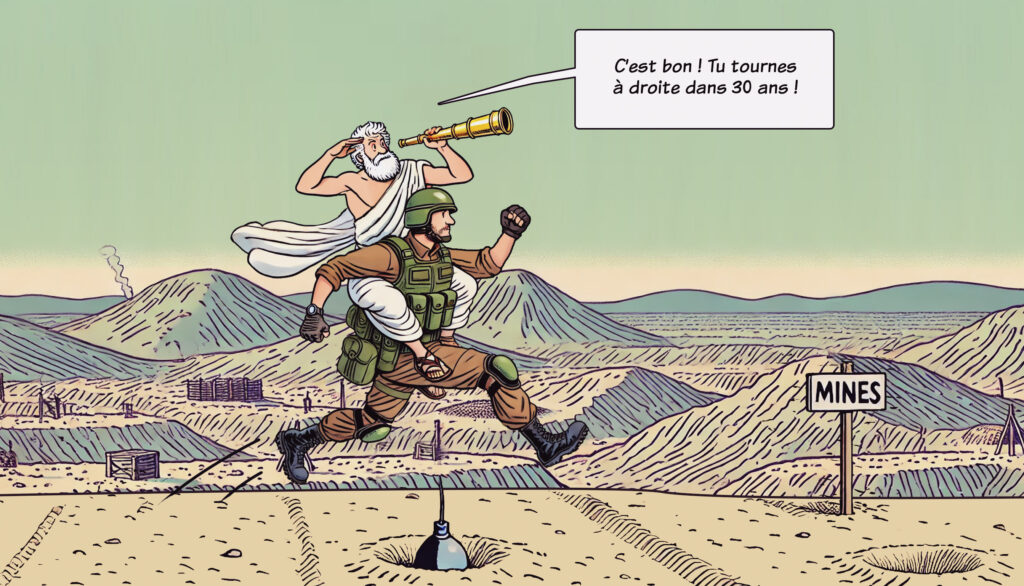
Parallèlement à cette montée en conscience, la vision métastratégique à long terme doit impérativement s’accompagner d’une résilience tactique immédiate. Or celle-ci constitue l’autre grand impensé de l’accompagnement au changement sous sa forme actuelle.
Le monde qui vient exige donc d’intégrer ce que l’intelligence de l’ombre maîtrise depuis des millénaires : la dimension tactique. Celle-ci comprend trois composantes essentielles, qui sont :
- L’anticipation des scénarios critiques : cartographie systématique des vulnérabilités, identification des points de rupture potentiels et élaboration de plans de contingence
- La gestion de l’incertitude radicale : développement de l’agilité décisionnelle, le maintien de multiples options ouvertes en permanence et la capacité à pivoter rapidement
- La coordination en contexte chaotique : les protocoles de communication de crise, les chaînes de commandement adaptatives et la mobilisation rapide des ressources
L’art de la résilience collective
Cette dimension tactique ne s’improvise pas. Elle requiert un apprentissage spécifique qui va bien au-delà des formations classiques au management de crise ou à la continuité d’activité. Il s’agit d’acquérir un véritable art de la survie collective, qui passe par la lecture fine des signaux faibles, la capacité à distinguer le bruit du signal, la coordination distribuée en situation dégradée et l’identification et la préservation des actifs critiques.
Cette évolution impose une transformation profonde du métier d’accompagnant. Au-delà de leurs compétences traditionnelles, ils devront désormais maîtriser une vision prospective large et long-termiste pour construire un avenir désirable, combinée avec la capacité à développer l’antifragilité organisationnelle au quotidien.
Cette hybridation entre métastratégie et intelligence tactique n’est pas un luxe : c’est une nécessité vitale pour les organisations qui veulent traverser les turbulences qui s’annoncent, la question n’étant plus de savoir si elles vont arriver, mais uniquement quand et dans quel ordre.
Le code source de notre destin collectif
Au terme de cette exploration, une évidence s’impose : la clé maîtresse pour naviguer dans les turbulences à venir ne réside ni dans la technologie, ni dans les processus, ni même dans les structures organisationnelles elles-mêmes. Elle se trouve dans la compréhension fine de ce que j’appelle notre « logiciel psychique collectif », cette matrice invisible de récits, de croyances et de schémas mentaux qui détermine nos comportements individuels et collectifs.
Les décennies qui viennent promettent des percées technologiques extraordinaires : intelligence artificielle générale, fusion nucléaire, médecine régénérative, colonisation spatiale et bien d’autres, qui ont le potentiel de propulser l’humanité dans une nouvelle ère de prospérité et d’expansion. Mais ces avancées, aussi spectaculaires soient-elles, ne garantissent en rien que nous éviterons un effondrement partiel ou total de notre civilisation, car la technologie amplifie autant nos sagesses que nos folies.
C’est pourquoi la compréhension et la transformation de notre logiciel psychique collectif est si cruciale. Ce programme, installé couche après couche depuis des millénaires, constitue à la fois notre plus grande force et notre principale vulnérabilité. Force, car il contient toute la sagesse accumulée par l’humanité dans sa longue marche. Vulnérabilité, car certaines de ses routines sont devenues obsolètes, voire dangereuses dans le contexte actuel.
Le prochain article explorera en détail ce « code source » de notre destin collectif. Car si nous voulons véritablement nous réinventer face aux défis qui nous attendent, nous devons d’abord comprendre ce qui nous programme. Non pas pour effacer ce programme — ce serait aussi impossible que dangereux — mais pour le faire évoluer consciemment vers une version plus adaptée aux enjeux du 21ème siècle.