Un monde asimovien
Je suis un lecteur assidu de science-fiction depuis ma plus tendre adolescence, si bien que les débats actuels sur l’IA, loin d’apparaître comme une rupture, me donnent simplement l’impression que la réalité rejoint ce que mon imaginaire a exploré depuis longtemps. Je pense en particulier au Cycle des robots où Isaac Asimov a anticipé à quoi ressemblerait un monde où les machines intelligentes seraient omniprésentes.
L’un des traits frappants de ces romans est qu’ils montrent un futur où le travail a disparu. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut envisager l’IA non telle que nous la connaissons aujourd’hui, mais telle qu’elle va devenir d’ici quelques années, quand elle va se combiner à d’autres technologies.
Un premier exemple de synergie technologique est le text-to-speech (TTS). Récemment, OpenIA a ajouté une fonctionnalité sur la version payante de son application mobile qui permet de parler directement avec GPT, qui répond de façon quasi instantanée aux questions avec une voix humaine. En d’autres termes, alors que les gens découvrent à peine le prompt, nous avons déjà fait un saut supplémentaire vers les ordinateurs intelligents de Star Trek.
Cette technologie va ouvrir une ère où des assistants vont offrir une écoute nuancée et empathique dans tous les domaines, des centres de support technique à l’assistance médicale ou juridique. Il est même fort possible qu’elle signe la fin des smartphones et des ordinateurs tels que nous les connaissons, qui seront remplacés par un simple écran ou des lunettes en réalité augmentée qui afficheront des informations essentielles tandis que l’IA écrira les e-mails, produira les rapports et organisera notre semaine à notre place.
Les robots apprenants
On parle peu de la robotique, mais dans ce champ-là aussi, les progrès sont vertigineux. Les inventions de Boston Dynamics relèguent la notion de robot maladroit aux oubliettes de l’histoire. Leurs machines, telles que Spot ou Atlas, démontrent une dextérité qui défie l’imagination :
Ces prodiges ne sont pas de simples gadgets, mais les précurseurs d’une révolution industrielle, médicale et domestique sans précédent. Combinés à une IA, de tels robots ne se contentent pas d’exécuter les tâches pour lesquels ils sont programmés : ils en apprennent de nouvelles. Le robot Figure, grâce à l’IA qui le pilote, a récemment appris à faire un café en regardant un tutoriel. L’anecdote sembler anodine, mais le potentiel que cela ouvre est vertigineux, car un robot capable d’apprendre peut évoluer quasiment à l’infini.
L’ère où l’homme enseignait méticuleusement chaque mouvement à ses créations fait place à un nouveau chapitre : un chapitre où la machine s’éveille, observe, imite et transcende. Imaginez un monde où chaque robot, armé de capteurs visuels, d’algorithmes avancés et d’un réseau neuronal artificiel, devient un travailleur infatigable et apprenant qui ne connaît ni l’ennui, ni la saturation, et encore moins la procrastination. Un employé modèle capable d’accroître ses compétences sans interruption et sans jamais demander de pause-café — sauf s’il est en train d’apprendre à le faire pour vous !
La vitesse surhumaine d’adaptation technologique bouscule les frontières de l’aisance professionnelle et domestique. Un robot qui apprend n’est pas simplement un outil : c’est un investissement qui fructifie à chaque seconde, s’enrichissant d’une base de données d’expériences pratiques qui l’amènent à exceller dans tous les domaines, devenant simultanément ouvrier, secouriste, cuisinier, agriculteur, soignant ou même artiste.
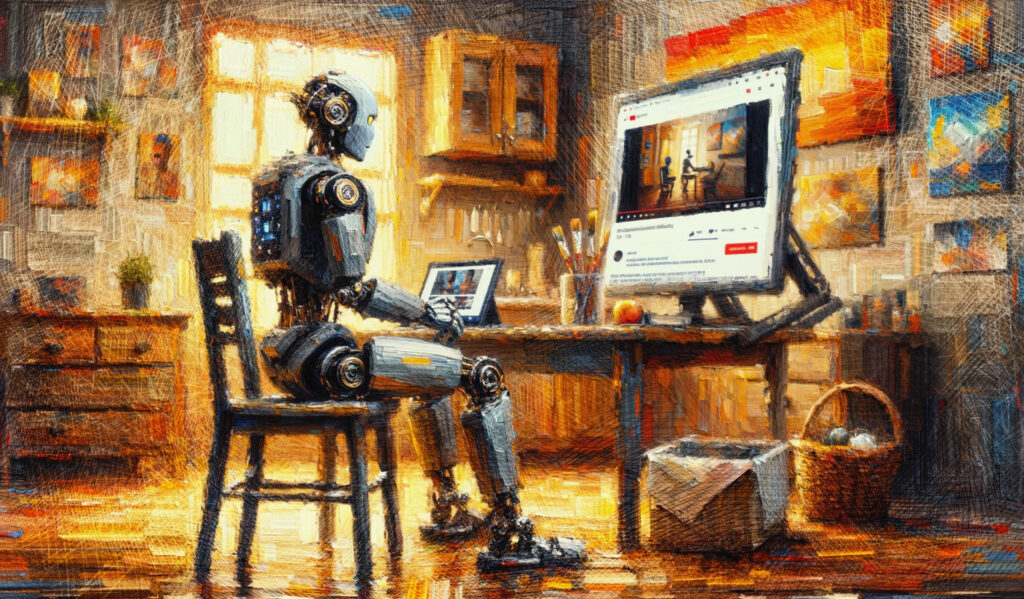
Une révolution dans la révolution : les réseaux adverses
Cela ne s’arrête pas là : non seulement les IA apprennent de nous, mais elles apprennent entre elles. Jusqu’ici, c’étaient les humains qui enseignaient aux IA à distinguer un chat d’un chien. Imaginez à présent deux IA lancées dans un ballet compétitif où l’une apprend tandis que l’autre l’éduque. À chaque microcycle d’apprentissage, l’élève affine ses modèles et l’évaluateur affûte son jugement dans un processus exponentiel.
Le résultat de cette synergie vertigineuse ? Un accéléré de progrès qui transforme radicalement les industries, des IA qui développent des médicaments personnalisés plus rapidement que n’importe quelle société pharmaceutique, qui conçoivent des matériaux révolutionnaires, ou qui imaginent les prototypes de véhicules électriques de prochaine génération. Les Generative Adverse Networks (GAN) sont le réacteur surpuissant propulsant la recherche-développement vers des cimes jusque-là inatteignables.
L’économie de demain sera régulièrement secouée par des innovations nées de cette forge d’innovation permanente. À mesure que les IA se bonifient par ce processus d’auto-amélioration compétitive, le marché foisonne de services et de produits toujours plus ajustés aux désirs et besoins humains. Cela peut nous amener — bien plus vite que nous l’imaginons — dans le monde décrit par Asimov, où des IA pilotent des véhicules autonomes, construisent des villes entières, gèrent des écosystèmes, anticipent les maladies, réalisent des opérations chirurgicales et partent même visiter l’espace.
Et nous dans tout cela ?
Reste alors la question cruciale de savoir ce qui va advenir de l’humanité dans ce tourbillon de changement. Alors que certains prophétisent une obsolescence de l’homme face à la machine menant droit à une dystopie transhumaniste, d’autres annoncent une ère utopique où l’homme sera enfin affranchi du travail dans un monde désormais guidé par la symphonie des algorithmes.
Ma prédiction est que nous allons bien parvenir à ce second état, mais en passant d’abord par le premier. Il n’y a pas d’étude menée à une large échelle pour mesurer le niveau de conscience de la population, mais en s’appuyant sur les résultats de l’expérience de Milgram et d’autres expériences sur la conformité sociale, on peut estimer qu’environ deux tiers de la population actuelle est insécure, vis dans un rapport parent-enfant à l’autorité et préfère suivre le troupeau.
Quant au tiers restant, sa conscience est diminuée par des facteurs structurels comme le travail qui nous aliène et nous maintient dans un stress permanent, le divertissement qui nous encourage à fuir le réel, les réseaux sociaux qui nous hypnotisent et enfin le système économique qui cultive nos blessures identitaires pour nous forcer à les compenser par la consommation.
Face à cela, nous avons des leaders qui doivent gérer des systèmes qui ont l’inertie tranquille d’un camion de dix tonne lancé vers un ravin et qui raisonnent de plus sur du court terme en privilégiant leur agenda et leur intérêt, preuve en est la multiplication des possédants qui, à l’image de Mark Zuckerberg, se construisent des abris de luxe pour préparer la fin du monde.
L’inaction collective
Cela signifie que dans l’ensemble, chacun va se concentrer sur son pré carré et il n’y aura aucun mouvement collectif d’ampleur pour exiger que cette révolution technologique serve à créer les fondements d’une civilisation nouvelle. Du fait de cette passivité, les forces qui vont instrumentaliser l’IA seront les mêmes que celles qui ont récupéré à leur compte les révolutions industrielles précédentes.
Pour l’instant, le discours des gouvernements et des entreprises se veut rassurant sur le sujet, consistant à annoncer que l’IA sera régulée et qu’elle ne détruira pas d’emplois. En réalité, s’il est vrai que l’IA va surtout automatiser des tâches plutôt que des métiers à proprement parler, ce qui va décider de son usage réel est une contrainte simple et implacable : la concurrence.
Dans un contexte mondial où les investisseurs pressurisent toujours plus les entreprises pour qu’elles dégagent une marge bénéficiaire, la question va très vite se résumer à un rapport coût / performance qui va pencher de plus en plus en faveur de l’IA. Par conséquent, même si les IA automatisent les tâches plus que les métiers, le nombre d’humains nécessaires pour réaliser un ensemble de tâche sera de moins en moins important.
Cela signifie que la montée en puissance de l’IA et des robots va se traduire par des entreprises qui licencient en masse, phénomène qui commence déjà à se produire et va continuer à s’amplifier. Les seules organisations qui vont échapper à ce processus sont les administrations publiques, qui parce qu’elles sont financées par un investisseur captif qui s’appelle le citoyen, pourront se permettre de conserver leurs effectifs même si la machine se montre, dans l’absolu, plus performante.
L’accroissement des inégalités

Face à cela, les gouvernements vont chercher à réguler l’usage de l’IA. Seulement, comme les États représentant aujourd’hui l’échelon suprême en termes de droit, il suffira aux grandes corporations de s’installer dans des pays aux législations moins regardantes. Si bien que loin de créer un équilibre, les tentatives de régulation vont encore plus défavoriser les entreprises locales qui jouent le jeu de l’emploi au profit de monstres transnationaux dont les moyens technologiques écrasants vont leur donner une mainmise encore plus importante sur le marché.
Nos comportements de consommation quotidiens vont faire de nous des complices de cette monopolisation. Quand on y songe, les solutions des GAFAM reposent sur une forme d’exploitation du patrimoine : un touriste qui arrive à Paris, prend un Uber pour se déplacer et dort dans un AirBnB prive les hôtels et taxis locaux de leur source de revenus. Par ailleurs, cela revient à confier nos données, désormais plus précieuses que l’or, à des forces qui cherchent la domination et se soucient peu du bien commun.
Et comme ces corporations sont actuellement en train de faire la course pour prendre le contrôle de l’économie mondiale, cela va se traduire dans une course au contrôle des usages de l’IA, qui va passer par le rachat d’une vague de start-ups qui vont se monter autour de cette technologie, la peur des GAFAM étant désormais d’être détrônés par le geek qui construit un produit révolutionnaire entre deux parties de Fortnite. Si bien que plus nous allons continuer à consommer leurs services pilotés par IA, et plus nous allons appauvrir des entreprises locales dans un cycle délétère.
En d’autres termes, l’AI-ficafion de la société va se traduire par le fait que chaque heure de travail sur la planète va alimenter une surconcentration de la richesse entre quelques mains. Selon les rapports de l’OXFAM, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites, près de deux fois plus que le reste de la population mondiale, et 148 grandes entreprises ont réalisé 1800 milliards de dollars de bénéfices cumulés — soit 52 % de plus en moyenne sur les 3 dernières années — et distribué d’énormes dividendes à de riches actionnaires tandis que des centaines de millions de personnes ont été confrontées à des réductions de salaires réels ou des licenciements.
La tentation du totalitarisme
Face à cette situation, on pourrait s’attendre à ce que les États réagissent. À ceci près que ces derniers sont aujourd’hui occupés ailleurs, surtout soucieux de préparer une troisième guerre mondiale dont les contours se dessinent de plus en plus précisément. Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses mondiales en matière de défense ont continué d’augmenter atteignant 1981 milliards USD en 2020, marquant ainsi une hausse pour la cinquième année consécutive. Récemment, un rapport confidentiel de l’armée allemande projette le début d’une troisième guerre mondiale à l’horizon de l’été 2025.
Là aussi, il y a une forme de pression concurrentielle et face aux tensions géopolitiques grandissantes, il faut s’attendre à ce que l’IA et les robots soient utilisés comme des armes, à la fois militaires sur les champs de bataille, mais aussi pour instaurer des formes de contrôle social augmenté comme c’est déjà le cas en Chine, sachant qu’un nombre croissant de pays s’engagent désormais dans la voie autoritaire.
Toute l’Amérique du sud regarde aujourd’hui avec admiration le « miracle salvadorien » porté par le jeune président Nayib Bukele, dont la popularité dépasse les 90% parce qu’il a fait disparaître la violence des gangs. Sa recette est simple : il a mis en prison de façon indiscriminée tout ce qui pouvait s’apparenter à un délinquant, le simple fait de porter un tatouage étant considéré comme un crime passible de plusieurs années d’emprisonnement dans des centres pénitentiaires qui se sont transformés en enfer.
Avec la pression gigantesque de la migration climatique, qui promet déjà d’être le défi géopolitique du siècle, la prochaine étape logique pour des régimes opportunistes sera de saisir la technologie comme un levier supplémentaire de domination, avec des vagues de réfugiés qui fourniront un terrain de jeu propice à l’expansion de politiques autoritaires déguisées en mesures de protection. Un signe précurseur en est la montée de partis d’extrême-droite en Europe, qui se sont désormais constitués en réseau.
Des États exsangues
L’IA, dans une tournure orwellienne, ne sera plus seulement l’architecte de nos commodités quotidiennes, mais le gardien d’une citadelle verrouillée. Et le piège du confort personnel ne fera que renforcer ces chaînes invisibles. Une population abreuvée de technologies facilitantes et divertissantes aura peu de disposition à se soulever contre un système qui érode discrètement ses libertés fondamentales en échange du maintien de sa zone de confort économique et numérique.
Il est également probable que la pression conjuguée de ces facteurs mène tout droit à des situations d’effondrements partiels ou complets de pays entiers. Le modèle démocratique, à bout de souffle, se traduit aujourd’hui par des dirigeants politiques qui accumulent la dette sans se soucier du lendemain. Le rapport 2021 de l’International Monetary Fund (IMF) indiquait que la dette publique mondiale a atteint un niveau record, s’approchant de 100% du PIB mondial.
Pour un certain nombre de pays, le chômage de masse provoqué par l’IA pourrait être la goutte d’eau qui va faire déborder le vase. Ce scénario a déjà écrit ses premières pages dans l’histoire récente. Pris dans le tourbillon de leurs propres engagements irréalistes, des États tels que la Grèce se sont retrouvés au bord du précipice, contraints de s’accrocher aux lignes de crédit tendues par les institutions internationales. Non loin de là, le Liban, autrefois célébré comme la Suisse du Moyen-Orient, subit une descente aux enfers financière sans précédent.
Les cas du Zimbabwe, avec son hyperinflation légendaire, du Venezuela ou de l’Argentine, autrefois prospère et aujourd’hui asphyxiés par la crise économique, dressent également un tableau sombre et lugubre. Ces pays, victimes de gestions calamiteuses, d’inflation galopante et de corruption endémique, illustrent l’énorme fossé entre les espérances des peuples et les faillites retentissantes de leurs gouvernements.
Le syndrome Solon
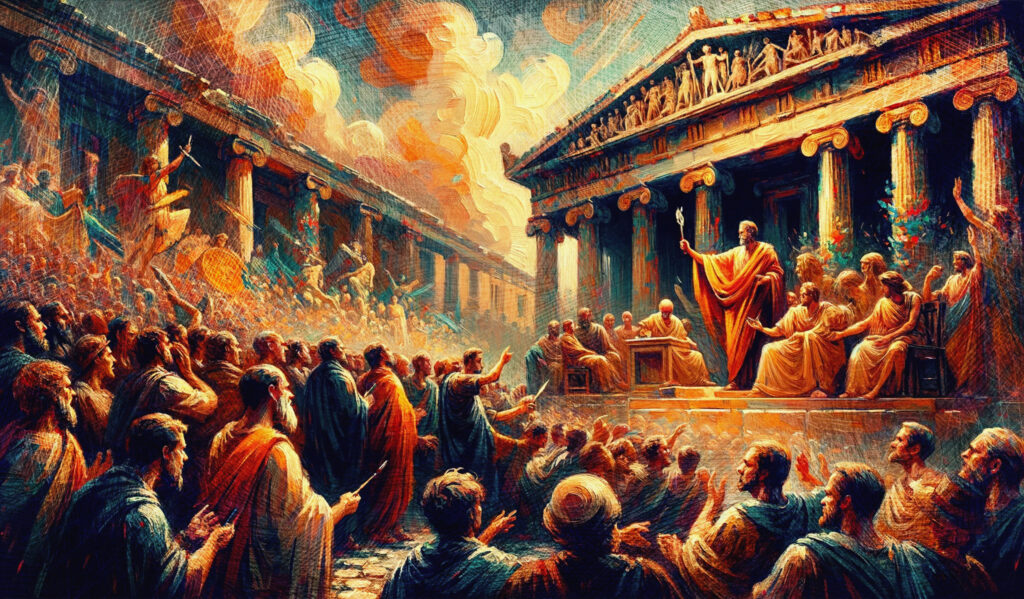
Ce sombre tableau, pour déprimant qu’il paraisse, est cependant un tremplin vers un éveil. Ce que je nomme le « syndrome Solon » est un phénomène qui s’est produit vers 600 avant J.-C. On sait très peu de choses sur l’histoire d’Athènes avant cela. À cette époque, la citoyenneté était héréditaire, ce qui signifie que tous les Athéniens étaient des descendants des tribus qui ont fondé la cité. Le statut d’esclave était réservé aux étrangers.
Cela change lorsque les Athéniens décident d’adopter une invention qui va tout changer : la monnaie. Le principal avantage de celle-ci est de dématérialiser partiellement la valeur et donc de faciliter l’échange et le développement économique. Toutefois, elle présente aussi un désavantage — dont les Athéniens de l’époque n’ont pris conscience que trop tard — qui va entraîner la cité dans l’esclavage.
Car l’apparition de la monnaie s’accompagne de la prolifération d’une population de prêteurs qui, en pratiquant des taux d’usure, endettent une partie des fermiers. Nombre de ceux-ci se retrouvent acculés à vendre leur terres pour assurer le remboursement de leurs dettes, puis finalement, lorsque ce n’était pas suffisant, à se vendre eux-mêmes et toute leur famille comme esclaves.
La situation prend une telle ampleur que la révolte se met à gronder, menaçant l’aristocratie. En réponse à cette crise de la dette, les grandes familles athéniennes prennent alors une décision radicale : elles décident d’élire à la tête de la cité un homme qui serait à même de la guérir des méfaits provoqués par l’argent. Leur choix se porta alors sur Solon, un personnage de sang royal qui avait contribué à faire gagner à Athènes la guerre contre Mégare, mais qui avait surtout voyagé de par le monde, dénonçant abondamment les abus des riches.
La mise en place de lois humaines et équitables assura le rétablissement d’un équilibre sain dans la cité. Avec l’abolition de l’esclavage pour non-paiement des dettes, la ville retrouva sa prospérité, et les esclaves qui avaient été vendus à l’étranger sont rapatriés à Athènes. Solon s’assura également d’élargir la base du pouvoir, tous les citoyens étant désormais appelés à participer à l’Assemblée. Il contribua ainsi à construire la démocratie telle qu’elle allait exister dans les siècles à venir.
« Si tu regardes dans l’abîme… »
Ce qu’illustre cet épisode historique est que l’apparition d’une grande invention technique — l’argent — s’est traduite par un tel déséquilibre social qu’elle a entraîné l’élaboration d’une deuxième grande invention politique — la démocratie.
De la même façon, l’IA va probablement accentuer les contradictions et les déséquilibres qui caractérisent la société humaine actuelle jusqu’à les porter à un point de rupture. Aujourd’hui, la fascination que nous avons pour l’IA tend à occulter l’essor de technologies tout aussi révolutionnaires que la blockchain et les DAO (Organisation Autonome Décentralisée) qui peuvent réinventer la gouvernance des sociétés humaines telle que nous la connaissons.
Imaginez qu’au lieu du rituel de vote qui alimente l’électoralisme, le lobbysme et la mainmise des partis, émerge un système où chaque citoyen peut s’exprimer à travers des référendums permanents, et où la richesse et le pouvoir de décision sont distribués non en fonction du contrôle de l’argent, mais selon la contribution et la valeur produite.
Les fondements de que je décris existe déjà. Des municipalités ou des régions en proie à des problèmes récurrents confient progressivement la structuration de leurs gouvernance à des acteurs innovants qui déploient des DAO et des cryptomonnaies pour crée des systèmes d’administration, de décision et de business ultra simplifiés.
Un douloureux réveil
Cependant, il serait naïf de croire qu’un tel basculement se fera sans heurts. La démocratie telle que nous la connaissons n’a pas évolué depuis des siècles et parmi tous les secteurs ont été révolutionnés par le digital, le seul qui ne s’est pas significativement transformé a été celui de la politique.
Il y a une bonne raison à cela, qui est que si cette dimension de la société change, toute la superstructure formée par les élites, le partis, les gouvernements, et les États vont se retrouver en situation d’obsolescence. Autant dire qu’ils ne vont pas se précipiter pour que cela se produise.
Par conséquent, il est malheureusement nécessaire que, à l’instar des Athéniens de l’Antiquité, nous passions par une série de crises qui vont nous amener à transformer nos croyances sur le fonctionnement de la cité et finalement comprendre que nous avons le pouvoir de décider de notre destin par de nouveaux moyens.
Les révolutions industrielles successives ont toutes porté une promesse d’émancipation, et ont toutes renforcé les inégalités, redistribuant tout juste ce qu’il faut à la multitude pour empêcher la révolte sociale.
Ce renforcement continu de l’aliénation découle de plusieurs facteurs, qui se ramènent ultimement à une croyance partagée par la majorité : « je suis impuissant.e à changer le système ». C’est cette croyance qui paralyse l’action et étouffe l’imagination, qui est une faculté qui est actuellement beaucoup plus cruciale pour construire l’avenir que l’intelligence analytique.
Pour briser les chaînes de cette inertie collective et sortir l’humanité de sa léthargie actuelle, il faut des électrochocs. Cette prise de conscience ne sera pas dénuée de douleur. Les crises, par leur nature même, bousculent, font peur, mais elles ont aussi le pouvoir de remettre en question l’ordre établi et de pousser à la réflexion, à l’innovation sociale et politique.
L’enjeu réside non plus dans l’attente passive d’un futur où les bénéfices des avancées technologiques et industrielles se distribueraient miraculeusement de manière équitable, mais dans la capacité à se saisir de ces moments de crise pour engager une transformation radicale.
L’histoire, avec ses multiples rebondissements, nous a montré que ce ne sont pas les périodes de stabilité, mais bien les époques de bouleversements qui ont forgé les avancées les plus significatives de la civilisation. Il est temps d’embrasser le chaos et d’y puiser la force nécessaire pour montrer que, oui, un autre chemin est possible.

